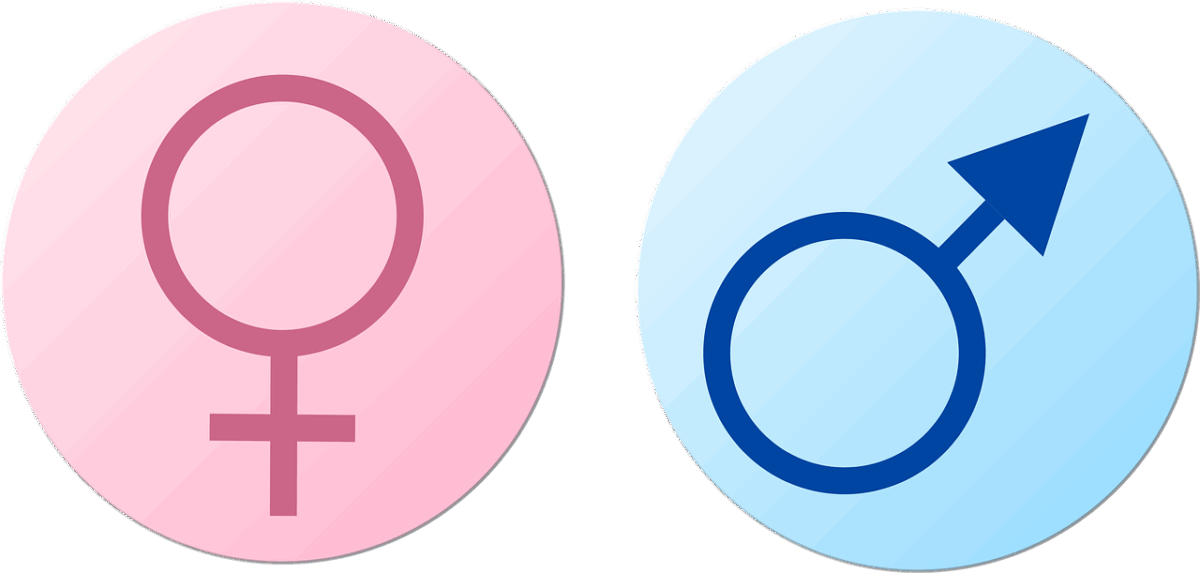
Subsiste-t-il une seule mauvaise bonne raison pour que persistent des écarts de rémunération entre hommes et femmes, toutes variables égales par ailleurs (formation, expérience, ancienneté, âge…), ceci après tant d’années de sensibilisation, de mesures, de discours et d’interventions ? On notera que l’article en question évoque essentiellement des “perceptions”, des “estimations” et des “ressentis”. Quoiqu’il en soit, il convient de ne rien lâcher sur le sujet et néanmoins d’observer les progrès significatifs obtenus. (NDLR)
Les salariées expriment des écarts de perception persistants par rapport à leurs homologues masculins sur la rémunération, la reconnaissance la flexibilité, et les risques psychologiques, selon une étude menée par Great Place To Work. Pourtant, des pistes existent pour y remédier, pour lesquelles l’action des managers est nécessaire.
Verre à moitié plein ou à moitié vide ? 37% des actives françaises ne se sentent pas traitées équitablement eu égard à leur genre. Mais 63% ont bien l’impression d’un traitement équitable quel que soit leur genre. C’est ce que révèle Great Place To Work For Women, l’étude de Great Place To Work consacrée au regard des femmes sur l’égalité professionnelle.
A un an de l’entrée en application de la directive européenne sur la transparence des salaires, la question de l’équité salariale demeure centrale. Dans les entreprises sondées, 84% des hommes estiment que les femmes et les hommes perçoivent la même rémunération à poste égal et profil équivalent. Elles ne sont que 75% à partager ce constat. Cet écart de perception se retrouve sur la plupart des thématiques abordées dans l’enquête. Il ne s’agit d’ailleurs souvent pas que de ressenti : plusieurs études, notamment publiées par l’Association professionnelle pour l’emploi des cadres (Apec) montrent une moindre rémunération et un moindre accès aux postes à responsabilité des femmes.
Les femmes évaluent ainsi un peu plus négativement la valeur accordée à leur travail : 38% considèrent que celui-ci est rémunéré à sa juste valeur, contre 42% des hommes. Elles sont aussi légèrement moins nombreuses à juger équitable le partage des bénéfices (36% contre 39%). La reconnaissance quotidienne souffre du même déséquilibre : moins d’une sur deux (46%) estime que son management valorise le travail bien fait et les efforts supplémentaires, contre 49% des hommes.
L’accès aux responsabilités stratégiques accentue ce ressenti d’injustice : 81% des hommes estiment que les chances sont équivalentes entre les genres pour accéder à des postes de direction, contre 72% des femmes. Par ailleurs, un peu moins de femmes que d’hommes perçoivent la fonction de direction générale comme attractive (55% contre 59%).
Lorsqu’on leur demande d’identifier les principaux freins à l’évolution de carrière, les femmes pointent d’abord la maternité et la vie de famille (33%), puis les comportements sexistes ou misogynes (21%). Suivent la culture d’entreprise (14%) et l’autocensure (14%). Si les hommes reconnaissent la vie de famille et le sexisme comme sources de difficultés pour les femmes à progresser professionnellement, une partie d’entre eux estiment que les femmes sont en partie responsable de leur moindre progression, puisqu’ils citent comme freins, à la place de la culture et l’autocensure, le manque d’envie de progresser et le manque de compétences.
Satisfaction au travail : des attentes différentes
La majorité des répondantes disent trouver du sens à leur activité, et même un peu plus que leurs confrères (56%, contre 53 % des hommes). Elles sont aussi très majoritaires et un peu plus nombreuses que les hommes à considérer leur emploi comme une source d’épanouissement personnel (73% contre 70%). En revanche, elles se déclarent globalement moins satisfaites par les autres aspects de leur emploi.
Il faut dire que la motivation ne provient pas exactement des mêmes sources selon les sexes. Les leviers de motivation mis en avant par les femmes sont l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle (47%), suivi de l’autonomie (37%) et de la rémunération (31%). Les hommes sont d’accord sur l’autonomie et l’équilibre, mais pas dans cet ordre (respectivement premier, à 44%, et troisième, à 32%), et dans leur trio de critères figure en deuxième place la convivialité, à 35%. Ces différences se reflètent dans les raisons qui pourraient pousser à quitter une entreprise : pour les femmes, la relation avec le manager est déterminante, tandis que les hommes citent le manque de convivialité.
Enfin, 22% des femmes évaluent leur santé mentale comme mauvaise ou très à risque, contre 17% des hommes. Un quart d’entre elles déclarent aussi que leur activité nuit à leur équilibre psychologique au quotidien (19% des hommes). L’exposition au stress est particulièrement marquée pour les 45-54 ans : 72% des femmes de cette tranche d’âge estiment que leur travail en est une source, contre 57% des hommes. Tout âge confondu, c’est 65% contre 58%. Les deux sexes jugent en outre insuffisantes les actions mises en place par leurs employeurs sur la santé mentale : seules 30% des femmes et 36% des hommes considèrent que leur entreprise agit concrètement pour la prévention et le soutien face à ces risques.
Une formation correcte, une flexibilité inégale
L’accès à la formation reste globalement satisfaisant, même si les femmes apparaissent un peu en retrait : 81% ont bénéficié d’au moins une formation au cours de l’année (84% des hommes), mais elles restent un peu moins nombreuses à déclarer avoir acquis de nouvelles compétences (52% contre 56%). Sur l’intelligence artificielle, elles s’estiment aussi moins informées : 48% jugent leurs connaissances insuffisantes, contre 38% des hommes. S’agissant d’une autoévaluation, l’étude ne permet pas de savoir si les femmes sont réellement moins bien formées sur l’IA générative, ou si elles sont plus sévères avec elles-mêmes que les hommes.
Par ailleurs, les femmes se disent davantage contraintes par leur employeur sur leur lieu de travail (41% contre 29% des hommes) ou sur l’usage du télétravail : 50% assurent pouvoir en faire lorsque c’est nécessaire, contre 62% des hommes. Elles sont aussi plus nombreuses à désapprouver le recul observé dans certaines entreprises sur le télétravail (56% contre 49%). Enfin, elles jugent plus difficile de prendre un congé en cas de besoin (50% contre 54%).
Bonnes pratiques : des leviers concrets pour les managers
Face à ce constat, les managers ont un rôle crucia à jouer pour tendre vers plus d’égalité professionnelle. C’est aussi ce qu’a voulu montrer Great Place To Work, en mettant en avant les bonnes pratiques des entreprises lauréates de son palmarès. Parmi celles qui ressortent, on retrouve notamment des programmes de mentorat et de leadership féminin pour mettre en avant des role models et accompagner les carrières, avec par exemple du coaching, du parrainage, des tables rondes, des master class… Certaines entreprises mènent aussi des actions de prévention contre le sexisme ordinaire et les biais de recrutement, en renforçant l’objectivité de ceux-ci et la place des salariées dans le processus de recrutement. L’entreprise Figma impose par exemple une formation annuelle obligatoire aux managers pour les sensibiliser à la diversité, l’inclusion et l’égalité professionnelle femme – homme. Manutan Pichon forme aussi ses équipes de ressources humaines sur ces thématiques, et Movinmotion les sensibilise spécifiquement aux biais de recrutement. D’autres sociétés prennent des mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, avec de la formation et des modes de contact spécifiques pour les témoins et les victimes. Enfin, certains dispositifs visent aussi la progression salariale et la promotion ciblées sur les femmes.
Source : Cadremploi


