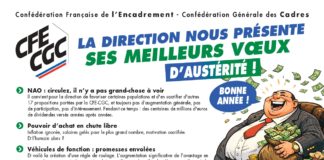Ce 1er juillet est entré en vigueur un décret qui impose aux employeurs de nouvelles obligations pour protéger leurs salariés durant les périodes de fortes chaleurs. Alors que le pays a connu cette semaine des températures très élevées, Cadremploi a fait le point avec une avocate sur ce qui pourrait changer au travail.
Ce 1er juillet est entré en vigueur un décret qui impose aux employeurs de nouvelles obligations pour protéger leurs salariés durant les périodes de fortes chaleurs. Alors que le pays a connu cette semaine des températures très élevées, Cadremploi a fait le point avec une avocate sur ce qui pourrait changer au travail.
Plusieurs dizaines de départements en alerte canicule, dont une dizaine en alerte rouge : cette semaine, la France a été particulièrement éprouvée par la chaleur. Et c’est justement ce mardi 1er juillet qu’est entré en vigueur un nouveau décret, qui ajoute des obligations aux employeurs lors des périodes de forte chaleur.
Le Code du Travail imposait déjà aux employeurs une obligation générale de sécurité de leurs salariés. « L’obligation de sécurité et de résultat a toujours pesé sur l’employeur. Même s’il n’était pas expliqué par quels moyens, l’employeur devait s’adapter », rappelle l’avocate Deborah Fallik, associée en droit social au cabinet Redlink.
Jusqu’à présent, peu de mesures étaient définies, excepté dans quelques secteurs comme le BTP. Or, avec le dérèglement climatique et l’augmentation des températures ces dernières années, cela devient un vrai sujet en entreprise. Pour les salariés qui travaillent en extérieur, évidemment, mais pas seulement.
C’est pourquoi le décret n°2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a modifié le Code du travail pour définir des mesures précises à prendre en cas de fortes chaleurs.
Les employeurs ont intérêt à prendre ce sujet au sérieux, car ces nouvelles règlementations pourraient avoir un impact sur l’indemnisation des accidents du travail, avertit Deborah Fallik. Quand un employeur a commis une faute inexcusable ayant entrainé un accident du travail, le salarié peut prétendre à une indemnisation complémentaire. Or, « une faute inexcusable, c’est typiquement ne pas avoir respecté une réglementation. Comme désormais, il y a des préconisations précises, le salarié pourra pointer celles qui n’ont pas été respectées et ont pu concourir à la réalisation de l’accident ».
Climatiser et fournir de l’eau
Ainsi, l’article R. 4223-13 du Code du travail, qui jusqu’à présent imposait seulement de chauffer les locaux fermés en hiver, prévoit maintenant qu’ils soient « en toute saison, maintenus à une température adaptée. […] En cas d’utilisation d’un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse ». L’objectif est d’éviter qu’ils deviennent trop chauds l’été. Cela ne veut pas nécessairement dire installer une climatisation, rassure l’avocate Deborah Fallik : l’employeur doit « réguler la température. Mais ce serait très compliqué d’obliger à installer la climatisation, il y a trop de contraintes, ne serait-ce qu’en matière d’urbanisme ». Elle estime que « pour tous ceux qui ont des locaux adaptés, cela ne posera pas problème. C’est plus compliqué pour ceux dont les locaux ne sont pas climatisés, ou dont le travail s’effectue à l’extérieur ».
Autre point : l’accès à l’eau potable, déjà mentionné dans le Code du travail, fait désormais l’objet de plusieurs articles : (articles R. 4225-2, R. 4463-3, R. 4463-4, R. 4534-143, R. 717-84-2). L’employeur doit s’assurer que les salariés aient de l’eau potable à disposition, et dans le cas contraire il doit fournir au moins trois litres d’eau par salarié et par personne.
Revoir l’organisation du travail
Une nouvelle section et en particulier (l’article R. 4463-3 du Code du travail) déroule une liste précise de mesures à envisager en cas de fortes chaleurs. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il doit tout appliquer mécaniquement, mais pour chaque mesure, l’employeur doit évaluer ce qui est pertinent en fonction du poste de travail et de l’activité.
L’employeur doit d’abord mettre en œuvre des « procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ». Une indication assez vague, reconnait l’avocate, mais qui peut recouper notamment l’organisation du travail et l’agencement des postes.
L’employeur doit en effet mettre en place « Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées » (par exemple par l’isolation) et modifier « l’aménagement et l’agencement des lieux et postes de travail ». Cela signifie, selon l’avocate, qu’en l’absence de climatisation par exemple, il faut « éviter d’avoir des surfaces vitrées en contact avec le soleil. S’il y a de grandes verrières, c’est compliqué, l’employeur peut faire installer des ventilateurs, des stores, mais il doit s’assurer qu’il y a assez de lumière ».
L’employeur doit aussi veiller à « L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ». Selon l’avocate, cela concerne essentiellement les personnes travaillant en extérieur, et devrait être un sujet important. Cela peut passer par « peut-être commencer plus tôt le matin. Peut-être imposer des pauses pour être sûr qu’elles soient prises ». Elle voit subsister un flou dans la formulation, la période de repos pouvant sous-entendre soit « une augmentation des pauses » durant le temps de travail, soit « des salariés mis en repos s’ils ont travaillé dans des conditions difficiles, comme un repos compensateur. J’aurais envie de penser que ce sont des pauses dans la journée, pour ne pas laisser une personne travailler six heures d’affilée, mais avoir des périodes de travail plus courtes », et potentiellement plus de rotations.
Selon elle, cette disposition pourrait aboutir à des contentieux, en cas d’accident du travail. « En cas de malaise ou d’accident, les salariés pourraient pointer que les conditions de travail ne permettaient pas d’exercer sereinement leur fonction », entre autres si les pauses n’ont pas été suffisantes – mais cela devra s’accompagner d’autres éléments pour constituer « un faisceau d’indices ».
Dans les bureaux, l’adaptation à la chaleur peut aussi passer par plus de télétravail quand les locaux ne sont pas climatisés. En extérieur cela peut par exemple consister à faire exécuter les tâches à l’ombre ou en intérieur aux heures les plus chaudes, et garder le travail exposé quand la température descend. Mais cela n’est possible que pour les entreprises « qui ont le choix de modifier le lieu de travail ». Surtout, ces aménagements pourraient engendrer des retards dans les chantiers. Or, souligne Deborah Fallik, « il n’y a pas de loi disant que tout retard pris sur un chantier parce que l’employeur a respecté ses dispositions ne pourra pas lui être reproché ». Une solution envisageable selon elle serait que les contrats incluent à l’avenir la possibilité de retarder un chantier pour protéger les salariés sans pénalité… A condition que le retard soit imputable exclusivement à la chaleur.
Changer de dress code ?
Autre obligation : « Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ». Cela s’accompagne de la fourniture d’équipements de protection individuelle pour se protéger de la chaleur et du soleil. Cette seconde obligation concernera plus les travailleurs extérieurs, qui devront donc avoir des équipements de protection contre le soleil.
Mais dans les bureaux, le choix d’équipements de travail appropriés pourrait relancer un vieux débat vestimentaire. « Comme on est censés adapter les équipements, notamment pour maintenir une température corporelle stable, je me suis posé la question du short pour les hommes », pour qui il est dans certains secteurs plus compliqué que pour les femmes de venir jambes nues au travail. « Dans certains secteurs, la banque d’affaires, certains cabinets d’avocats, là où il y a une représentation face à la clientèle, la tenue vestimentaire est codée, et cela semble impossible de ne pas venir en costume », reconnait l’avocate. Elle tempère en expliquant que dans des locaux climatisés, cela n’est pas forcément un problème pour les salariés. Mais dans le cas contraire, la question va se poser : l’entreprise pourra-t-elle « sanctionner un salarié qui ne respecte pas le dress code ? La réponse sera non ».
S’informer, informer, former…
En parallèle, un arrêté, lui aussi du 27 mai 2025, définit précisément seuil d’intervention des employeur : ils doivent prendre des mesures dès que le niveau de vigilance pour canicule définis par MeteoFrance est jaune.
Les entreprises doivent également mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels, en incluant les risques liés à la chaleur. Le décret prévoit aussi « L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ». De plus, l’employeur doit pouvoir des modalités de signalements des symptômes liés à la chaleur (article R. 4463-6 du Code du travail). Pour Deborah Fallik, cela revient à informer les salariés de la conduite à tenir en cas de symptômes, à élaborer avec la médecine du travail. L’information peut se faire par voie d’affichage, mais elle reconnait que les affichages deviennent très nombreux. Elle conseille donc aussi de le rappeler lorsque surviennent les fortes chaleurs.
Source : Cadremploi